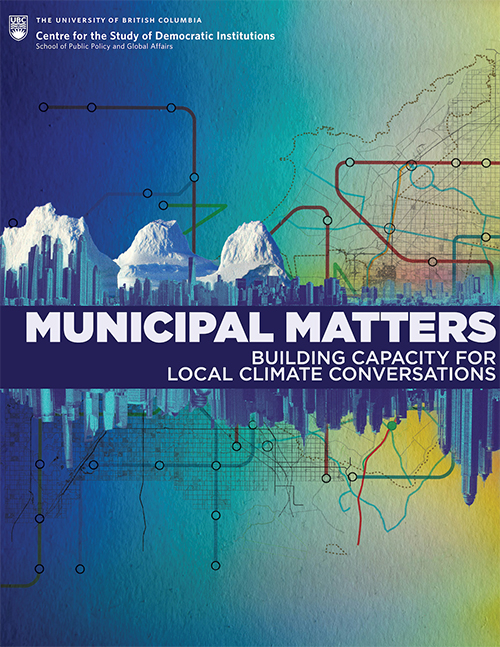L’Internet a apporté d’énormes avantages sociaux, politiques et économiques ces 30 dernières années. Toutefois, ces avantages ont également entraîné des coûts considérables. La phase actuelle de l’Internet a vu la croissance et la consolidation de quelques entreprises de plateformes mondiales au cours des 15 dernières années. Les préjudices attribués aux plateformes comprennent l’ingérence dans les élections, les discours nuisibles et haineux, ainsi que la désinformation. Ces préjudices vont à l’encontre des objectifs de construction de communautés plus fortes et plus inclusives et de promotion d’un environnement sûr permettant aux Canadien·ne·s de faire l’expérience d’expressions culturelles diverses.
Ces questions font l’objet d’une attention croissante et les mesures réglementaires se multiplient dans le monde entier. Les gouvernements ont commencé à tester des stratégies pour gouverner la sphère publique numérique, convergeant vers ce que les spécialistes appellent un programme de gouvernance des plateformes. Des organisations à but non lucratif telles que l’Internet Archive continuent de travailler sur une vision de l’Internet d’intérêt public. En même temps, les chercheurs ont commencé à définir une approche interdisciplinaire du rôle des plateformes dans la société et de la manière dont les régimes de gouvernance nationaux et internationaux pourraient y répondre. Les recherches s’intéressent à des disciplines telles que la communication, l’étude des médias, l’histoire, le droit, l’informatique, la psychologie, la science politique, la politique publique, le journalisme et la sociologie
Bien qu’encourageant, le discours émergeant dans le milieu de la recherche et les politiques publiques sur la gouvernance des plateformes reste trop souvent cloisonné par sujet. Les milieux de la recherche et de la politique restent également largement déconnectés. Nous souhaitons donc proposer un ensemble de 16 articles courts pour répondre à ces deux problèmes.
Ces articles arrivent à point nommé pour aborder les questions relatives à la gouvernance des plateformes au Canada. Les projets de loi C-11 ou C-18 sur le contenu ne sont pas passés inaperçus dans la presse. Il en va de même pour le processus de consultation du gouvernement sur un éventuel projet de loi sur la sécurité en ligne. Trop d’études se sont donc concentrées sur la question du contenu, les politiciennes musulmanes et les candidat·e·s politiques en général, la citoyenneté connectée au Canada et les origines de la désinformation sur Twitter. Les élections constituaient également un point central, tout comme l’infodémie pendant la Covid-19.
De nombreuses mesures ont également été prises, dont la loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD, en anglais : AIDA), la législation potentielle sur la sécurité en ligne et les réformes de la Loi sur la concurrence, à commencer par le projet de loi C-19 adopté en juin 2022. Alors que le gouvernement canadien entreprend un programme de gouvernance des plateformes, il est nécessaire de définir un cadre global et synthétique pour intégrer tous ces projets de loi et efforts réglementaires.
Cette sélection d’articles applique au contexte canadien un cadre de compréhension et de mise en œuvre de la gouvernance mondiale des plateformes développé par Nanjala Nyabola, Taylor Owen et Heidi Tworek en 2021-2022. Cette approche systémique est essentielle pour aborder l’éventail des problèmes dans cet espace et pour déterminer l’ensemble des solutions possibles.
Notre cadre propose quatre domaines interconnectés de gouvernance des plateformes : le contenu, les données, la concurrence et l’infrastructure. Bien qu’il existe déjà une base de connaissances au Canada sur ces quatre domaines, ces derniers sont rarement interconnectés, et les données parfois insuffisantes.
Le contenu : Les problèmes prioritaires concernant les conséquences négatives de la désinformation, de l’extrémisme violent et des discours haineux liés au contenu. Les entreprises de plateformes ont eu des difficultés à modérer ces contenus, se contentant de les supprimer ou d’en réduire la visibilité dans l’édition automatisée des flux de médias sociaux. Comme ces problèmes attirent souvent l’attention du public, nous avons inclus six mémoires qui abordent différents aspects de la réglementation du contenu, allant des influenceur·euse·s des médias sociaux pendant les élections (Elizabeth Dubois) et de la réglementation des préjudices en ligne (Emily Laidlaw) aux croyances des Canadien·ne·s sur la réglementation des services de messagerie privée (Sam Andrey) et au rôle de l’effet paralysant (Jon Penney). Plusieurs articles traitent des efforts législatifs actuels tels que le projet de loi C-11 sur la diffusion continue en ligne (Robyn Caplan), et le projet de loi C-18 sur la manière dont les plateformes en ligne pourraient rémunérer les organismes de presse pour leur contenu (Vivek Krishnamurthy).
Les données : Si les politiques axées sur le contenu attirent le plus l’attention, les données sont aussi au centre des discussions concernant la LIAD. Les recherches portant sur les données ont abordé, entre autres, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRDE, en anglais : PIPEDA) et la gouvernance de l’IA, les droits de la personne et la protection des données, et la souveraineté des données des Premières Nations. Alors que nous nous efforçons d’améliorer la LIAD (Christelle Tessono), d’autres articles envisagent de nouvelles approches des données en général, qu’il s’agisse des définitions des sphères publique et privée (Wendy Chun et Prem Sylvester) ou du plaidoyer en faveur d’un nouveau concept de « données d’origine humaine » (Teresa Scassa).
La concurrence: L’ampleur sans précédent que prend l’économie des plateformes numériques soulève de nouvelles questions sur la manière de réglementer les marchés. Alors que l’Union européenne, par exemple, a adopté une législation sur les marchés numériques en juillet 2022, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les possibilités et les effets potentiels au Canada, en particulier lorsque la Loi sur la concurrence entrera dans la deuxième phase de la réforme au cours de l’année prochaine. Ce moment offre de nouvelles occasions de stimuler l’innovation (Keldon Bester) ou de repenser la bonne approche de la concurrence et des plateformes (Jennifer Quaid), sans oublier toutefois d’examiner de près des entreprises canadiennes comme Shopify (Vass Bednar). Seuls deux articles évalués par des pairs semblent exister sur Shopify, par exemple. L’un de ces articles a été rédigé par des chercheur·euse·s allemand·e·s basé·e·s en Allemagne et n’a pas examiné la plateforme d’un point de vue canadien. Le second article, rédigé par des chercheur·euse·s pakistanais·e·s, se penche sur les évaluations de l’application Shopify.
L’infrastructure : L’écosystème de la plateforme repose sur des infrastructures de communication, de calcul, d’énergie et humaines. Les recherches sur les infrastructures au Canada ont déjà abordé des sujets comme la fracture numérique dans les communautés rurales autochtones, Huawei et la géopolitique de l’infrastructure d’Internet, ainsi que le projet Quayside de Sidewalk Labs. Mais l’infrastructure comporte bien d’autres aspects. L’apparition de ChatGPT et de l’IA générative a permis de démontrer comment les entreprises peuvent utiliser et potentiellement abuser des infrastructures actuelles et des régimes juridiques qui sous-tendent le contenu en ligne disponible (Rob Hunt et Fenwick McKelvey). L’infrastructure montre comment les plateformes sont liées à un espace de gouvernance beaucoup plus large, comprenant les droits du travail (Eric Tucker), la géopolitique (Blayne Haggart), l’Internet des objets et l’environnement (Sonja Solomun).
Plutôt que de proposer une solution miracle à partir d’une seule politique, ces 16 articles explorent différents aspects de la gouvernance des plateformes afin de comprendre comment ils fonctionnent ensemble et comment ils peuvent évoluer ensemble, et de dégager des recommandations spécifiques pour le Canada. Ce dernier objectif est particulièrement crucial, car le gouvernement canadien légifère actuellement sur de nombreux aspects du programme de gouvernance des plateformes. Ces éléments contribueront, nous l’espérons, à faire en sorte que tout programme de gouvernance tienne compte de l’ensemble des questions relatives aux plateformes et envisage une approche systémique de la gouvernance des plateformes.
Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Nous tenons à remercier Internet Archive Canada d’avoir généreusement organisé un atelier à Vancouver en février 2023, au cours duquel nous avons discuté des versions préliminaires de ces documents. Nous remercions également Kshitij Sharan et Rebecca Monnerat d’avoir aidé à organiser cet atelier. Nous remercions également Chris Tenove pour sa contribution et son aide pendant l’atelier.